Certains courent, d’autres nagent, tous ou presque font des check-up réguliers. Mais quels que soient leur âge et leur forme, les chefs d’État africains répugnent à dévoiler leur état de santé. Et s’ils sont vraiment malades, ils ne l’avouent qu’en dernier recours. Jeune Afrique a passé en revue l’état de santé de dix-huit dirigeants du continent.
La question que pose Jeune Afrique cette semaine suscitera fatalement des commentaires antagonistes. Les citoyens ont-ils droit à la vérité quand il s’agit de la santé de leur président ? Ou celle-ci relève-t‑elle de la vie privée ? Personne n’a tranché, encore moins les intéressés, alors que les interrogations sont nombreuses quant à l’aptitude de certains d’entre eux à présider aux destinées de leur pays.
Citons pêle-mêle Muhammadu Buhari, rentré depuis peu de Londres après y être resté plus de cent jours sans avoir fourni la moindre explication crédible, Abdelaziz Bouteflika, retranché dans sa résidence de Zeralda d’où aucune information ne sort, Robert Mugabe, dont l’âge (93 ans), les siestes en public et les alopécies inexpliquées posent question, ou encore le départ annoncé de José Eduardo dos Santos après les élections du 23 août, alors que ses séjours dans divers établissements de Barcelone se sont multipliés ces dernières années.

Ceux qui se sont résignés
Peu jusque-là ont été disposés à admettre – par leurs mots ou leurs actes – leur incapacité à gouverner. Pourtant, la conduite de l’État ne peut souffrir aucune incertitude. En 1999, après des années de maladie, Hassan Gouled Aptidon s’est résigné à transmettre les rênes de Djibouti à son neveu, Ismaïl Omar Guelleh.
Trente-quatre ans plus tôt, rongé par un cancer du poumon, l’ancien président gabonais Léon Mba s’était finalement décidé à désigner un successeur en la personne d’Albert Bongo – devenu Omar Bongo Ondimba (OBO). Selon le chef d’État mourant, ce dernier était le seul dans son entourage à avoir « du courage et de la volonté ».
En 1966, Mba nomme depuis Paris son directeur de cabinet au poste de vice-président via un enregistrement expédié à Libreville par Jacques Foccart, le « Monsieur Afrique » de l’Élysée. OBO devient alors le dauphin constitutionnel. Il prend le pouvoir deux ans plus tard, alors que Mba décède loin de son pays sans jamais avoir admis son inaptitude à diriger.
Le désordre que provoquerait une vacance du pouvoir non organisée par la loi ou la coutume est tellement redouté que le mensonge est souvent préféré à la vérité. Le premier président camerounais, Ahmadou Ahidjo, en a d’ailleurs joué d’une manière inattendue.
Ahmadou Ahidjo ne sachant comment partir sans être accusé de fuir ses responsabilités, organise, avec la complicité de son épouse Germaine, sa sénescence accélérée
Fatigué, sujet à des troubles de la mémoire provoqués notamment par la prise excessive de somnifères et de kola ainsi que par la consommation abusive de tabac, mais ne sachant comment partir sans être accusé de fuir ses responsabilités – ce que ne fait jamais un chef –, il organise, avec la complicité de son épouse Germaine, sa sénescence accélérée. Cette dernière livrera : « Il savait que s’il prévenait qui que ce soit, il serait l’objet d’un chantage au chaos qu’il risquait de déclencher.
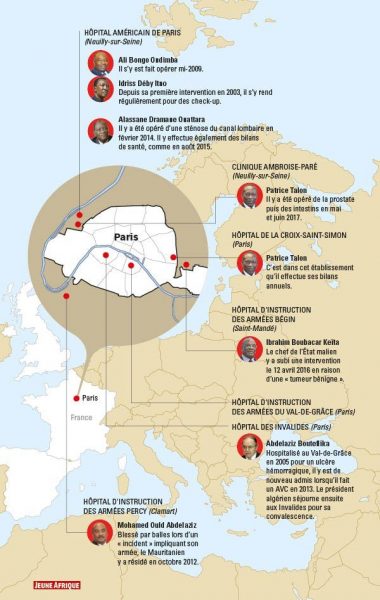
Le seul argument qui laisserait sans réplique serait l’évocation d’une maladie grave. Nous en avons parlé, nous avons mis au point les détails. Il préparerait les esprits, il jouerait les grands malades. Puis il partirait subitement pour Grasse, discrètement, mais confiant à quelques-uns qu’il allait consulter ses médecins. Je le rejoindrais.
Nous rentrerions ensemble et, immédiatement, il annoncerait sa démission. » Il respectera ce plan à la lettre, donnant les clés du palais d’Etoudi le 4 novembre 1982 à un certain Paul Biya. Dépressif, peut-être convaincu finalement d’être réellement malade, Ahidjo ne voulait pas s’accrocher : « Je ne suis pas Bourguiba », avait-il insisté.
Coup d’État médical
Il faut dire que la fin de règne du raïs tunisien, devenu irascible et irrationnel, fut interminable… Jusqu’à la publication d’un certificat médical, signé par sept professeurs de médecine sur ordre du Premier ministre de l’époque, Zine el-Abidine Ben Ali.
« Face à sa sénilité et à l’aggravation de son état de santé, nous fondant sur un rapport médical, le devoir national nous impose de le déclarer dans l’incapacité absolue d’assumer les charges de la présidence de la République », annoncera le chef du gouvernement à la radio le 7 novembre 1987, prenant de fait le pouvoir, comme le prévoyait l’article 57 de la Constitution.
Un « coup d’État médical » resté célèbre et possible notamment parce que les Tunisiens n’ont jamais su le véritable état de santé de Bourguiba.




